Etat profond, administration et post-matérialisme
- Christophe Carreau
- 3 juil. 2025
- 5 min de lecture
Dernière mise à jour : 26 août 2025
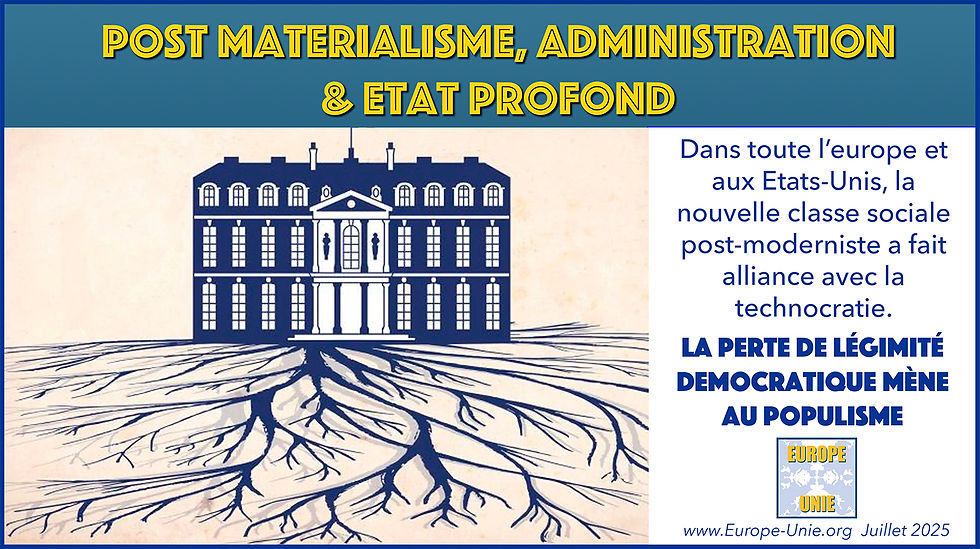
La frustration après la chute de la coalition Schoof (I) aux Pays-Bas
La coalition dite “Schoof”, dirigée par l’ancien haut fonctionnaire Dick Schoof et soutenue par le PVV de Geert Wilders, a pris fin prématurément en juin 2025. Elle avait été formée à l’issue des élections législatives du 22 novembre 2023, après une période de négociations qui s’est étendue jusqu’au 16 mai 2024, date de l’accord de coalition. Le gouvernement Schoof (I), officiellement investi le 2 juillet 2024, aura donc duré à peine une année, sa chute ayant été confirmée en juin 2025.
Aujourd’hui, nombreux sont les citoyens et les commentateurs voient dans ce cycle plutôt court, qui n’aura pas eu le temps de mettre en place les mesures promises lors de la campagne des législatives, une impuissance devenue chronique face à un « Etat profond » qui bloque les prises de décisions, face à une puissante administration qui détiendrait le pouvoir par l’enlisement et la paralysie.
« Aux Pays-Bas, comme dans de nombreux autres pays, il est pratiquement impossible de traduire une volonté largement partagée par l'électorat en politiques concrètes et opérationnelles. Qu'est-ce qui s’oppose donc à cela ? J'ai déjà évoqué les réflexes du «on ne peut pas » au sein des groupes parlementaires, du monde scientifique, des médias, des organisations non gouvernementales (ONG) et du système judiciaire. Un mandat électoral pourtant clair se heurte à une résistance interne et profonde de l’administration et de l’Etat.
Le processus politique primaire est largement mis à l'écart, ce qui entraîne une stagnation et une érosion du soutien social. Par exemple, notre contribution à la réduction du réchauffement climatique, par exemple, grâce aux mesures de transition énergétique, serait dérisoire, de l'ordre de 0,00068 °C en 2050 (il se peut que je me trompe d'une décimale ici et là). Mais on proclame cette nécessité haut et fort comme s'il s'agissait d'un article de foi. Voilà le deuxième phénomène qui explique l'impuissance politique: une doctrine post-matérialiste imposée par une classe sociale minoritaire qui dicte sa loi, caractérisée par une croissance démesurée de l’administration depuis le XVIIe siècle. ».
Cette préoccupation grandissante mène à un populisme lui aussi grandissant.
La frustration des électeurs face à l’Etat profond
Depuis plusieurs décennies, une frustration populaire croissante émerge en Europe et aux États-Unis. Cette colère naît du sentiment que les élections ne changent plus fondamentalement les politiques menées. Les populations constatent que, quels que soient les gouvernements élus, une même orientation idéologique — souvent post-matérialiste — domine : droits des minorités, écologie dogmatique, ouverture migratoire, etc. Cette ligne semble dictée non plus par le suffrage, mais par une caste administrative technocratique, fortement ancrée dans les institutions publiques. Cette élite, souvent issue des grandes écoles ou des universités, impose ses valeurs, contrôle les leviers décisionnels, et rend les alternatives politiques inopérantes. Le « vote sanction » devient alors un réflexe, mais ses effets sont neutralisés par les coalitions, les tribunaux ou l’inertie de l’État profond. Cette confiscation perçue du pouvoir démocratique nourrit les mouvements populistes, souverainistes ou protestataires. Le fossé s’élargit entre une élite urbaine et administrative, détentrice du récit dominant, et une population en quête de représentativité réelle.
La croissance de la technocratie depuis la seconde guerre mondiale
Depuis la Seconde Guerre mondiale, les États modernes ont connu une croissance massive de leurs administrations, impulsée par la reconstruction, la planification économique, la guerre froide, puis, et surtout, l’État-providence. Les hauts fonctionnaires, experts, magistrats, cadres de la santé, de l’éducation ou de la culture ont progressivement formé une technocratie spécialisée, légitimée par son expertise plus que par le suffrage. Avec le temps, cette caste administrative s’est institutionnalisée, occupant durablement les leviers de décision, au-delà des alternances politiques. Dans de nombreux pays européens, cette couche sociale issue des grandes écoles ou universités s’est alignée sur des valeurs post-matérialistes : écologie, droits des minorités, ouverture des frontières, globalisme. Progressivement, elle en est venue à défendre ses propres intérêts, ses carrières, ses paradigmes idéologiques, parfois au détriment de la volonté populaire. Ce phénomène alimente la thèse d’un « État profond » : une structure permanente, non élue, exerçant un pouvoir souterrain et filtrant les décisions politiques. Les institutions européennes, les juridictions supranationales ou les agences indépendantes renforcent encore cette tendance à la dépolitisation des choix publics. La souveraineté démocratique se retrouve dès lors concurrencée par une souveraineté administrative invisible.
Post-matérialiste et mutation des gauches en Europe
Depuis les années 1960-70, une nouvelle classe sociale a émergé dans les sociétés occidentales, issue de l’urbanisation, de la massification de l’enseignement supérieur et de la tertiarisation de l’économie. Constituée d’individus éduqués, souvent issus des milieux académiques, culturels, administratifs ou associatifs, cette classe adopte des valeurs post-matérialistes, centrées sur l’écologie, les droits des minorités, le multiculturalisme, l’égalité des genres et la justice sociale. Ces idéaux ne répondent plus aux besoins économiques fondamentaux, mais à des aspirations symboliques ou morales. Elle tend à s’opposer aux valeurs traditionnelles, productivistes ou nationales des classes populaires ou moyennes. Son influence s’étend dans les universités, les médias, les ONG, les institutions publiques et les partis de gauche ou centristes. Cette classe post-matérialiste s’apparente à une nouvelle élite morale, souvent déconnectée des réalités du monde ouvrier ou rural. Elle redéfinit les débats politiques en imposant des normes culturelles progressistes. Son poids grandissant dans l’appareil d’État et dans les sphères d’influence nourrit des tensions croissantes avec les classes populaires, alimentant en retour le vote protestataire et les mouvements dits populistes.
L’émergence de cette classe post-matérialiste a profondément modifié la sociologie électorale et idéologique de la gauche en Europe. Historiquement tournée vers la défense des classes ouvrières, la gauche a progressivement intégré les revendications de cette nouvelle élite morale : écologie, droits identitaires, égalité des genres, multiculturalisme. Parallèlement, la technocratie – forte de sa croissance depuis 1945 – a largement relayé ces valeurs dans les politiques publiques, les rendant structurelles. Cette convergence a favorisé une mutation des partis sociaux-démocrates traditionnels vers des partis “socio-culturels”, délaissant la défense du travail et du pouvoir d’achat au profit d’enjeux sociétaux. Le fossé avec les classes populaires s’est creusé, provoquant un exode électoral vers les partis populistes ou abstentionnistes. Les alliances entre gauches post-matérialistes et technocratie ont contribué à un éloignement croissant entre institutions et électorat populaire. Cette transformation a fragilisé la gauche traditionnelle dans de nombreux pays en Europe et aux Etats-Unis, entraînant sa marginalisation, voire son absorption dans des coalitions écologistes ou centristes.
Les partis de gauche, historiquement ouvriers et ancrés dans le marxisme économique, ont alors été “capturés” par cette nouvelle élite, au détriment de leurs bases populaires. Cette mutation idéologique a provoqué un glissement des classes populaires vers l’abstention ou les partis populistes. La gauche s’est fragmentée entre une gauche culturelle et urbaine, et une gauche résiduelle, ouvrière et nationale. Dans plusieurs pays européens (France, Pays-Bas, Allemagne), les anciens partis sociaux-démocrates ont décliné, absorbés ou remplacés par des forces écologistes ou centristes partageant les mêmes valeurs post-matérialistes. Cette recomposition a modifié durablement l’échiquier politique, au prix d’une perte de lien avec les couches sociales les plus modestes.
La montée des populismes
Face à l’emprise croissante de la technocratie sur les choix politiques, de nombreux pays ont vu émerger des mouvements qualifiés de « populistes », « souverainistes » ou de « démocraties illibérales ». Ces forces se nourrissent du sentiment d’abandon des classes populaires et moyennes, déconnectées des priorités post-matérialistes portées par l’élite administrative. Le vote populiste devient un moyen de reconquête du pouvoir démocratique et d’affirmation de la souveraineté nationale. En Europe centrale (Hongrie, Pologne), en Italie, aux Pays-Bas, en France ou aux États-Unis, ces mouvements critiquent les élites « hors sol », la centralisation administrative et la dilution du débat démocratique. Ils dénoncent un pouvoir technocratique qui impose ses dogmes sans légitimité électorale. En réponse, ces mouvements cherchent à restaurer un lien direct entre peuple et pouvoir exécutif, quitte à bousculer les normes institutionnelles. Ils se heurtent toutefois à la résistance des institutions, des médias et de l’appareil d’État, entraînant un climat politique tendu et parfois polarisé. Le conflit entre légitimité électorale et permanence administrative devient un enjeu majeur du XXIe siècle.

Commentaires